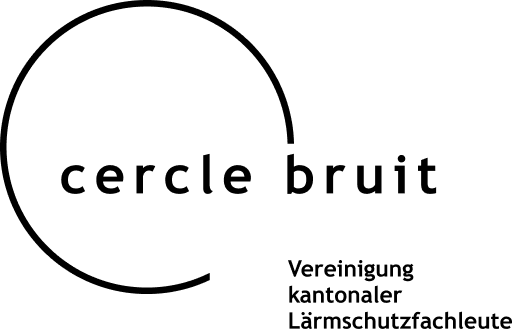En plus de mettre les nerfs à rude épreuve, le bruit provoque également des coûts importants : des coûts indirects sous forme de dépenses de santé et de pertes de revenu locatif, et des coûts directs lors de la mise en œuvre des mesures de lutte contre le bruit. Les trafics routier et ferroviaire constituent la principale source de bruit. Les coûts indirects, donc externes, des nuisances sonores imputables à ces deux types de trafic se chiffrent dans notre pays à près d’un milliard de francs chaque année. En revanche, seulement 160 millions de francs par an sont dépensés pour des assainissements acoustiques. Ces fonds sont principalement dévolus à la pose d’écrans ou de fenêtres antibruit.
Communiqué de presse (DE)
Communiqué de presse de la CFLB
Des études ont montré qu’à partir de 60 décibels en journée et 50 décibels la nuit, les volumes sonores étaient considérés comme gênants – et donc comme du bruit – par une grande partie de la population. Mais la perception du bruit est différente d’une personne à l’autre. Un même bruit ne sera pas considéré comme gênant par tout le monde. Des aspects tels que le type de bruit, le moment de la journée ou le bruit de fond entrent également en ligne de compte. Toutefois, le bruit ne fait pas que déranger, il a aussi un coût économique. Ainsi, il peut réduire la valeur de biens immobiliers et occasionner des coûts pour le traitement des problèmes de santé liés au bruit. Le bruit engendre des coûts externes. Les coûts externes sont la part des coûts qui n’est pas prise en charge par les responsables des nuisances, mais par des tiers, en l’occurrence la collectivité.
Les nuisances sonores sont générées par les usagers du trafic, mais ce sont les personnes qui habitent à proximité des voies de circulation qui en subissent les conséquences. Les coûts externes imputables au bruit du trafic routier et ferroviaire sont estimés à 998 millions de francs par an, soit environ 140 francs par habitant. 90% de cette somme revient à la dépréciation des biens immobiliers et 10% aux dépenses liées aux domaine de la santé. Ces chiffres ne prennent pas en compte les coûts externes du trafic aérien ou de la volonté d’échapper aux nuisances sonores (pour aller vivre à la campagne), ni de la perte de performance sur le lieu de travail ou à l’école en raison de difficultés de concentration.
Les logements bruyants sont moins attrayants
La question du bruit et de la valeur immobilière a pris de l’ampleur à cause du problème du bruit des avions. Or, en Suisse, des centaines de milliers de personnes vivent près de voies de communication bruyantes. Leurs logements perdent de la valeur en raison du bruit. Les appartements bruyants sont moins demandés que des logements comparables situés dans des zones calmes. Cette demande réduite se traduit concrètement par un loyer plus bas. Selon diverses estimations, la valeur d’un appartement décroît de 1 à 1,5 pour cent par décibel d’augmentation du bruit. Les premiers concernés sont les logements d’une et de trois pièces.
Les grands appartements de quatre pièces et plus se situent en général dans des endroits plus calmes. Les pertes de loyer induites par le trafic routier se montent à 770 millions de francs par année. Le trafic ferroviaire occasionne de son côté 100 millions de francs par année de pertes de loyer – soit sept fois moins que le trafic routier. Globalement, le bruit du rail et de la route est responsable de pertes de revenu locatif estimées à 874 millions de francs suisses. Ce chiffre n’inclut pas les mesures d’isolation acoustique.
Le bruit accentue aussi les problèmes sociaux. Ainsi, ce sont souvent des personnes à faible revenu qui vivent le long de voies de communication très bruyantes: personnes âgées, marginaux et familles monoparentales ou étrangères. Comme les recettes provenant des loyers sont peu élevées à cause du bruit, les propriétaires s’y intéressent peu et n’investissent pas dans ces logements. De fait, une ségrégation sociale s’instaure. Ceux qui en ont les moyens déménagent vers des quartiers moins bruyants.
Bien sûr, il existe aussi des logements chers dans des endroits bruyants. Néanmoins, les investissements (ventilation, vitrage spécial, etc.) y sont nettement plus importants. Parallèlement, ces sites disposent généralement d’autres atouts qui concourent à une certaine qualité de vie. Une étude de l’OFEV a révélé que les locataires de Zurich étaient prêts à débourser chaque mois environ 240 francs suisses de plus de loyer pour jouir d’un surcroît de tranquillité.
Coûts de la santé en hausse
Les conséquences des nuisances sonores pour la santé et la qualité de vie ne doivent pas être sous-estimées. Le bruit est souvent associé à des troubles auditifs. Or, même de faible intensité, le bruit peut avoir des répercussions sur la santé. Chaque fois que le corps est exposé à un bruit gênant, des hormones de stress sont sécrétées. Le cœur bat plus vite, la pression augmente et la respiration s’accélère. À terme, les personnes constamment exposées au bruit tombent malades, car leur organisme se trouve dans un état de stress permanent. Cette exposition prolongée peut provoquer troubles auditifs, de l’hypertension artérielle, des infarctus ou des troubles du sommeil. Le bruit peut aussi engendrer des problèmes de concentration et des troubles de l’humeur (dépression ou agressivité). Le corps n’a pas la capacité de s’accoutumer au bruit.
Les coûts du bruit pour les maladies liées à l’hypertension artérielle et à l’infarctus sont connus. Le manque de calme se solde par une facture annuelle de 124 millions de francs. Ces coûts se décomposent de la manière suivante :
- Coûts des traitements médicaux ;
- Coûts administratifs des assurances ;
- Perte de production : les personnes concernées sont provisoirement ou durablement incapables de travailler ;
- Coût de la prévention : coûts des mesures destinées à prévenir les atteintes à la santé (p. ex. loisirs dans des endroits calmes, changement de domicile, etc.) ;
- Coûts immatériels : perte de bien-être, douleur et souffrance des personnes touchées et de leurs proches.
La grande majorité des coûts – 95% – relève des coûts immatériels (douleur et souffrance). En revanche, on ne dispose d’aucun chiffre étayé sur l’ampleur des troubles de l’audition, de la concentration, du sommeil et du psychisme.
Fiche d’information sur les coûts du bruit, Office fédéral de l’environnement OFEV (DE)
Des manques à gagner dans le tourisme
Le bruit diminue la qualité de vie. Pendant nos loisirs et nos vacances, nous aspirons tous à une meilleure qualité de vie pour pouvoir nous ressourcer. De fait, nous évitons les zones bruyantes pour ces moments de temps libre. Cela génère encore des manques à gagner pour le tourisme, une utilisation réduite des zones de détente de proximité et des frais pour échapper au bruit. Il n’existe à l’heure actuelle aucune étude sur les coûts externes du bruit dans les domaines du tourisme et des loisirs en Suisse. Des estimations montrent toutefois que ces coûts pourraient atteindre jusqu’à 100 millions de francs par an.
Un nombre grandissant de routes et de voies ferrées assainies
Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la protection de l’environnement en 1985, 1 milliard de francs a déjà été investi dans l’assainissement de routes, dont trois quarts pour les routes nationales, et le quart restant pour les routes principales et autres routes. Jusqu’à présent, la majeure partie des fonds a été utilisée pour empêcher la propagation du bruit. Pour l’essentiel, des écrans antibruit ont été construits et des routes recouvertes. Quant aux dépenses restantes, elles ont porté sur des mesures de remplacement touchant aux bâtiments, comme la mise en place de fenêtres antibruit. À ce jour, environ un quart des routes suisses ont été assainies.
Grâce aux votes populaires de l’automne 1998 sur la modernisation du rail et le financement des transports publics, la question de la réduction du bruit ferroviaire a pu être prise à bras-le-corps. Au total, environ 1,8 milliard de francs a ainsi été débloqué. Grâce à l’amélioration du matériel roulant et la pose d’écrans et de fenêtres antibruit, quelque 260 000 personnes devraient être soustraites à une exposition excessive au bruit ferroviaire d’ici 2015. À ce jour, la réduction du bruit ferroviaire a coûté 1 milliard de francs.